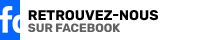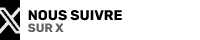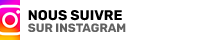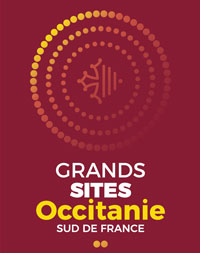REQUIEM de FAURE, Messe basse pour voix de femmes et orgue, Adagio de Samuel Barber et autres oeuvres...
Orchestre de Chambre de Toulouse, direction : Gilles Colliard
Ensemble vocal Unité, direction : Christian Nadalet
Soprano : Clémence GARCIA
Baryton : Christian NADALET
Direction : Patrick de CHIRÉE

On oublie parfois que l’histoire du Requiem s’apparente à un véritable feuilleton. Tout commence au milieu des années 1860 alors que Fauré accompagne régulièrement des enterrements à l’orgue. Il se lasse de toute une lourdeur musicale imposée par la mort et décide en 1887 de composer un ouvrage conforme à ses vœux. « La mort est une délivrance heureuse, une aspiration au bonheur », dit-il pour expliquer le caractère singulier de sa messe des morts ; l’une des premières à être écrite dans un esprit d’apaisement et non pas de souffrance. Point de Dies Irae, séquence apocalyptique jusque-là indispensable, rendez-vous compte !
Le Requiem de Fauré va connaître trois versions. Donnée pour les obsèques d’un paroissien, en l’église de la Madeleine à Paris le 16 janvier 1888, la première présente une instrumentation de couleur angélique : on entend des cordes, une harpe, des timbales et l’orgue. Fauré lui-même dirige et, à cette occasion, présente au public un garçon de dix ans qui chante le touchant solo du Pie Jesu. Il s’agit de Louis Aubert, futur compositeur et pianiste - que l’on retrouvera en 1911 pour la création anonyme des Valses nobles et sentimentales de Ravel !
Le 28 janvier 1892, à l’église Saint-Gervais, on découvre une nouvelle mouture de l’ouvrage : Fauré a ajouté l’Offertoire et le Libera me, pour baryton solo.
Il faudra attendre 1899 - et passer par des discussions acharnées entre Fauré et l’éditeur Julien Hamelle à propos de l’orchestration - pour enfin en arriver à la dernière version, un Requiem symphonique. Il est d’abord présenté à Lille, puis Paris pour l’Exposition Universelle de 1900 ou encore Bruxelles. Les critiques apprécient « sa simplicité et son raffinement », même si certains y voient trop de « demi-teintes et d’ombres légères ».
La version donnée ce soir est la première (1888) : Les voix sont accompagnées par les cordes, une harpe et un orgue. Gabriel Fauré justifiait sa démarche en expliquant que Dieu est avant tout « un gigantesque synonyme du mot Amour ».
En savoir plus
• Histoire de l’Orchestre de Chambre de Toulouse
• Ensemble vocal Unité
• Clémence GARCIA
• Christian NADALET
• Patrick de CHIREE